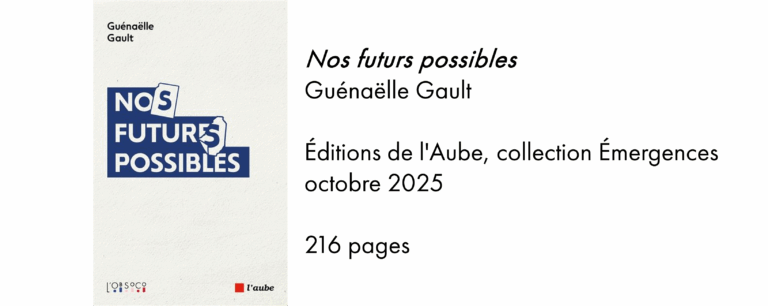Comment en sommes-nous arrivés là ? Les promesses fondatrices de la modernité – progrès, émancipation, maîtrise du monde – semblent se retourner contre nous. La raison produit de la complexité illisible, la technologie de nouvelles dépendances, la consommation du vide existentiel. Résultat : 57 % des Français estiment que leurs enfants vivront moins bien qu’eux, 62 % pensent que « c’était mieux avant », 42 % disent subir leur existence plutôt que de la choisir.
Pourtant, sous les décombres de ce récit décliniste affleurent d’autres désirs, d’autres horizons à inventer. Dans Nos futurs possibles, son nouvel essai qui sort aujourd’hui aux Editions de l’Aube, Guénaëlle Gault, notre Directrice générale, entend montrer que la crise que nous vivons n’est pas tant une crise du futur qu’une crise de notre capacité à l’imaginer ensemble.
Trois réponses à la crise moderne
L’ouvrage s’appuie sur une vaste étude menée par l’équipe de L’ObSoCo auprès de 4 000 Français. Ce travail de recherche identifie trois visions du monde en tension : une société techno-libérale (optimisation, fluidité, performance), une société identitaire-sécuritaire (ordre, continuité, enracinement), une société éco-solidaire (régénération, sobriété, reliance).
Quelques enseignements clés
Premier constat : aucun modèle ne l’emporte massivement. Nous sommes traversés par ces tensions contradictoires. Nous voulons à la fois plus de liberté et plus de sécurité, plus de fluidité et plus de racines, plus d’innovation et plus de mémoire. L’enjeu n’est donc pas de choisir un camp, mais d’apprendre à composer avec cette pluralité.
Deuxième constat : l’individualisation n’est pas notre problème, c’est notre condition. Contrairement aux discours ambiants, les Français ne veulent pas revenir en arrière. Même dans leurs contradictions, ils défendent farouchement leur autonomie. Le défi politique n’est plus de restaurer un grand collectif homogène, mais d’inventer les conditions d’une émancipation partagée dans un monde pluriel.
Troisième enseignement : nos outils politiques sont figés et dévoyés. Le compromis, au lieu de composer avec les différences, les efface. Le consensus, plutôt que d’organiser l’accord, exclut les voix dissonantes. Surtout : la confrontation, loin de structurer le débat, le brutalise.
Rendre les futurs tangibles
Pour faire sortir ces logiques de l’abstraction, l’essai franchit une étape inédite : transformer ces modèles abstraits en mondes narratifs concrets. Avec l’aide de l’IA générative, il construit trois sociétés fictionnelles – Eden Capital, La Citadelle, Ligara – que le lecteur peut visiter de l’intérieur : leurs institutions, leurs territoires, leurs modes de vie, leurs rituels quotidiens… Une « ethnographie fictionnelle » qui permet d’éprouver ce que ces logiques produiraient si elles allaient au bout d’elles-mêmes.
Cinq pistes pour rouvrir les possibles
Ces voyages dans nos futurs possibles ne sont pas un simple exercice d’imagination : ils font apparaître en creux les impasses de notre présent et les ressources inexploitées. D’où la dernière partie, qui esquisse cinq pistes concrètes pour rouvrir les possibles :
1. Encapaciter l’individu : rendre la liberté réellement praticable, pas seulement proclamée
2. Pratiquer l’art de la reliance : tisser du commun sans nier les différences
3. Structurer sans enfermer : inventer des cadres souples, évolutifs, résilients
4. Réhabiliter le conflit fertile : en faire un moteur démocratique plutôt qu’une menace
5. Raconter autrement : multiplier les récits pour ouvrir des chemins de sens
Non pas des solutions clés en main, mais une méthode pour cheminer dans l’incertitude sans abandonner personne.
Un livre pour tous ceux qui refusent la résignation
Nos futurs possibles s’adresse à tous ceux – décideurs, citoyens, chercheurs – qui sentent que quelque chose doit changer mais ne savent plus par où commencer. Il propose moins un programme qu’un déplacement du regard : cesser de voir la pluralité comme un problème à résoudre, pour en faire une ressource à composer.
Parce que oui, l’avenir est sombre. Mais comme l’écrit Rebecca Solnit, cette obscurité « tient autant de l’utérus que de la tombe » : elle porte en elle la gestation autant que la fin. A nous de choisir ! Les futurs – au pluriel – ne sont pas fermés d’avance. Ils attendent juste que nous retrouvions cette capacité fondamentale : imaginer ensemble ce qui n’existe pas encore.