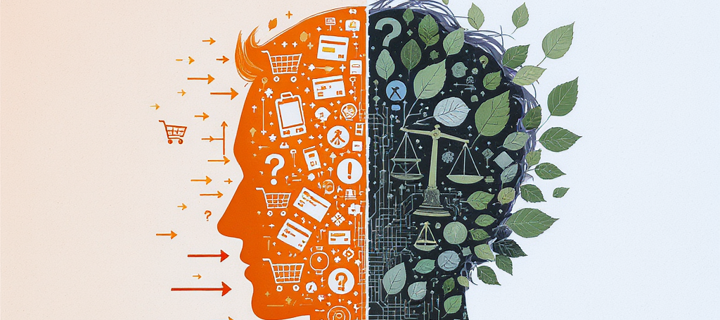Les données de notre dernier Baromètre trimestriel dessinent une France coupée en deux parts quasi égales. Si 51% des Français y restent attachés, 49% prennent leur distance vis-à-vis de la consommation. Au total, sur une échelle de – 5 à + 5, le score moyen d’attachement au modèle consumériste s’établit à -0,4. Nous voilà collectivement au point mort, suspendus entre deux mondes
.
On notera que ce sont les foyers modestes qui adhèrent le plus au consumérisme (56% pour les revenus sous 1000€ versus 45% au-delà de 2500€). De même, les peu diplômés (59%) y sont bien plus attachés que les BAC +5 (39%).
L’âge redessine aussi la carte : les 18-24 ans (48%) et surtout les 25-34 ans (39%) apparaissent moins consuméristes que les 65-75 ans (59%). Entre génération climat et génération Trente Glorieuses, l’écart est donc manifeste. Il l’est encore davantage sur le plan politique. Ainsi, 64% des Français très à droite défendent le modèle consumériste, contre 38% à gauche et 34% chez les proches des mouvements écologistes. Trente points d’écart : la consommation est clairement un marqueur idéologique à part entière, donc un enjeu politique.
Mais là aussi, il convient d’apporter de la nuance. Seuls 3% manifestent un attachement très fort au consumérisme, quand 48% y adhèrent modérément. À l’inverse, 14% en prennent fortement leurs distances, et 35% s’en éloignent doucement. Si la balance penche aussi peu d’un côté ou de l’autre, c’est que les positions tranchées restent minoritaires. La majorité des Français navigue dans l’entre-deux, tiraillée entre des convictions contradictoires.
Pour preuve : 83% des Français jugent qu’on accorde trop d’importance à la consommation — mais 75% affirment qu’elle contribue au bonheur. 79% reconnaissent que notre façon de consommer nuit à l’environnement — tout en étant 73% à la considérer essentielle à l’économie. C’est cette tension intime qui maintient le corps social en équilibre instable, entre lucidité critique et attachement pratique.
Des chiffres ne disent pas tant nos contradictions que notre héritage. Nous sommes les enfants d’un siècle qui a fait de la consommation sa promesse centrale : progrès, confort, émancipation, bonheur. Trois générations d’après-guerre ont construit leur vie sociale autour de ce pacte. Comment s’en détacher du jour au lendemain ? Comment renoncer à ce qui a effectivement apporté du confort, de la liberté, du plaisir ?
La tension n’est pas hypocrite, elle est structurelle. Elle révèle une société en transition, habitée par des aspirations toutes légitimes mais difficilement conciliables : désir de bien-être matériel et besoin de sens, nécessité de croissance économique et protection de l’environnement, attachement aux plaisirs de la consommation et sentiment diffus qu’elle ne remplit pas ce qu’elle promet, avoir versus être…
Deux Frances, donc ? Oui, mais pas dos à dos. Plutôt deux pôles d’aimantation qui nous tirent chacun de leur côté, dans un même corps social coincé entre l’héritage d’hier et les impératifs de demain. Une France en équilibre instable, au seuil d’un monde qu’elle peine encore à nommer.
Source : L’ObSoCo, Baromètre des Intentions et du Pouvoir d’achat
Septembre 2025